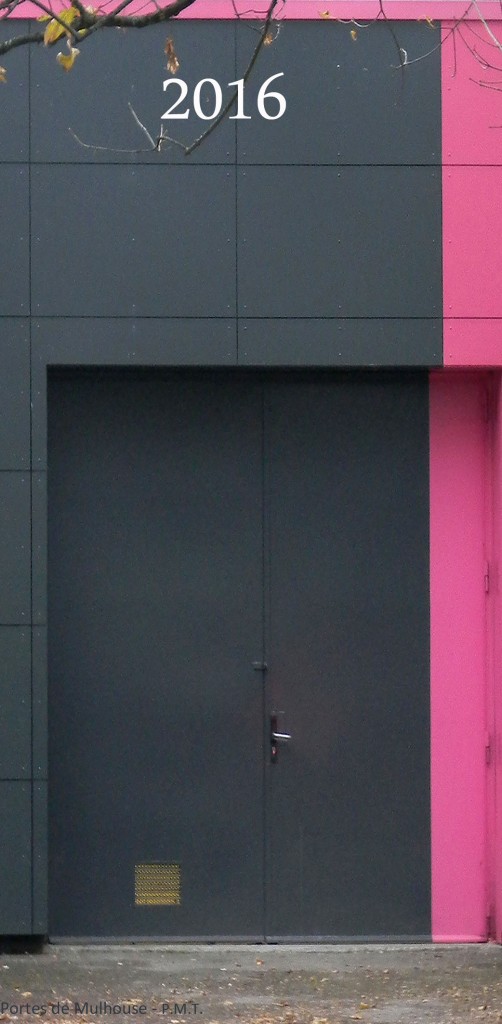“Et toi, ma petite, as-tu compris ma tristesse ? Tu vas la porter aux gens, mais je ne serai peut-être plus là. On me trouvera sous la terre… Sous des racines… » Zinaïda Evdokimovna Kovalenka, résidente sans autorisation.” (La supplication, Svetlana Alexievitch)
Fessenheim, ce dimanche 24 janvier. Concert du nouvel an pour toujours et toujours demander la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Fessenheim. Beaucoup viennent de l’autre côté du Rhin redevenu frontière puisque, état d’urgence oblige, les dangereux terroristes venus d’Allemagne pour l’occasion n’ont pu passer le fleuve qu’en donnant leur nom et leur numéro de passeport aux quelques pandores recrutés pour l’occasion.
 Dans le quotidien L’Alsace ce jeudi 28 janvier 2016, un article intitulé “Que faire en cas d’accident nucléaire ?” L’article (édition abonnés) rend compte d’une réunion publique sur le renouvellement des pastilles d’iode et les mesures à prendre, évacuation notamment, en cas d’accident. Etaient invités les habitants dans un rayon de 10 kms autour de la centrale !!! Il est vrai que le nuage de Tchernobyl s’était judicieusement arrêté à nos frontières françaises !!! Les villes proches ne seront donc pas inquiétées et les conseils municipaux, qui dorment l’âme en paix, n’ont donc même pas à aborder la question !
Dans le quotidien L’Alsace ce jeudi 28 janvier 2016, un article intitulé “Que faire en cas d’accident nucléaire ?” L’article (édition abonnés) rend compte d’une réunion publique sur le renouvellement des pastilles d’iode et les mesures à prendre, évacuation notamment, en cas d’accident. Etaient invités les habitants dans un rayon de 10 kms autour de la centrale !!! Il est vrai que le nuage de Tchernobyl s’était judicieusement arrêté à nos frontières françaises !!! Les villes proches ne seront donc pas inquiétées et les conseils municipaux, qui dorment l’âme en paix, n’ont donc même pas à aborder la question !
Inutile de revenir sur les faits : vieille centrale bâtie sur une faille sismique, ayant atteint la limite d’âge (personne n’est obligé de croire au discours officiel de la grande sécurité résultant d’un entretien – réparations – permanent) et se refroidissant sur un canal dont, réchauffement climatique aidant, les capacités peuvent devenir insuffisantes tout en étant directement très délétère sur l’environnement. La manne financière tombant sur la région contribue certainement à assurer le déni à l’origine des discours pro centrale. Sans oublier les arguments sur l’emploi.
Il est alors bon de relire, ou tout simplement de lire, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015 (La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse paru en édition de poche). A condition que le déni ne conduise pas à un autodafé mental. Les témoignages recueillis par l’auteure, et qui constituent l’ouvrage, montrent justement comment ce déni, des politiques, des institutions, des scientifiques et des travailleurs, a pu jouer avant, pendant et après l’explosion de la centrale de Tchernobyl. Ils montrent aussi, en plus de ce déni, la résignation à la mort des liquidateurs et autres travailleurs œuvrant sur et autour de la centrale après l’explosion (dont un certain nombre étaient, il faut le souligner, de recrutement forcé). Ils montrent aussi, et peut-être surtout, comment une population, elle aussi résignée à ses souffrances et à sa mort, reste attachée à sa région au point de refuser d’en partir, de continuer à vouloir y vivre au point d’y revenir parfois après une évacuation forcée, alors même qu’elle est définitivement mortifère.
A vos réflexions !
La supplication, quelques extraits :
“Si tout le monde était intelligent, il n’y aurait pas eu de sots. La centrale brûlait ? Et alors ? L’incendie est un phénomène temporaire. Personne n’avait peur. Nous ne connaissions pas l’atome. Je vous le jure sur la sainte Croix ! Et nous vivions tout près de la centrale : à trente kilomètres à vol d’oiseau. À quarante par la route. C’était très bien. On prenait le bus pour y aller. Ils étaient approvisionnés comme les magasins de Moscou. Du saucisson bon marché et de la viande à tout moment dans les magasins. C’était le bon temps !
Aujourd’hui, il ne reste que la peur… On prétend que les grenouilles et les moustiques survivront, mais que les gens mourront tous. Que la vie continuera sans les humains. Ce sont des contes et des racontars, mais il y a des crétins qui aiment les écouter. Et pourtant, il n’y a pas de conte sans une parcelle de vérité. C’est une vieille chanson…”
Anna Petrovna Badaïeva, résidente sans autorisation.”
“Notre régiment fut réveillé par le signal d’alarme. On ne nous annonça notre destination qu’à la gare de Biélorussie, à Moscou. Un gars protesta – je crois qu’il venait de Leningrad. On le menaça de cour martiale. Le commandant lui dit, devant les compagnies rassemblées : “Tu iras en prison ou seras fusillé.” Mes sentiments étaient tout autres. À l’opposé. Je voulais faire quelque chose d’héroïque. Comme poussés par une sorte d’élan enfantin, la plupart des gars pensaient comme moi. Des Russes, des Ukrainiens, des Kazakhs, des Arméniens… Nous étions inquiets, bien sûr, mais gais en même temps, allez savoir pourquoi !
Eh bien, nous y sommes allés, à la centrale. Chacun d’entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche et un masque de gaze. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillions en bas, à sortir les décombres et gratter des surfaces, et une journée en haut, sur le toit du réacteur. À la pelle. Les robots ne fonctionnaient plus, les appareils et les machines devenaient dingues, mais nous travaillions. Et nous en étions fiers !”
Un soldat
“J’y suis allé… Je pouvais l’éviter, mais je me suis porté volontaire. Dans les premiers jours, je n’ai pas rencontré de gens indifférents. Ce n’est que par la suite que j’ai vu des yeux vides… Lorsque tout le monde s’est habitué. Décrocher une décoration ? Des privilèges ? Des bêtises ! En ce qui me concerne, je n’avais besoin de rien. Un appartement, une voiture, une datcha… J’avais déjà tout cela. En fait, il s’agissait d’une affaire d’hommes. Les vrais hommes ne refusent pas les missions vraiment dangereuses. Les autres ? Ils restent dans les jupes de leurs femmes… Pour l’un, sa femme doit accoucher ; l’autre a des enfants en bas âge ; le troisième souffre de brûlures d’estomac… On lançait une bordée de jurons, et on y allait.
Nous sommes retournés chez nous. J’ai enlevé tous les vêtements que je portais et les ai jetés dans le vide-ordures. Mais j’ai donné mon calot à mon fils. Il me l’a tellement demandé. Il le portait continuellement. Deux ans plus tard, on a établi qu’il souffrait d’une tumeur au cerveau… Vous pouvez deviner la suite vous-même. Je ne veux plus en parler.”
Un liquidateur
“Un groupe de scientifiques est arrivé en hélicoptère. Ils portaient des vêtements spéciaux de caoutchouc, des bottes hautes, des lunettes de protection. Comme pour un débarquement sur la Lune… Une vieille femme s’est approchée de l’un d’eux.
Qui es-tu ?
- Un scientifique.
- Un scientifique ? Voyez comment il est affublé. Et
nous alors ?
Elle l’a poursuivi avec un bâton. Je me suis dit à plusieurs reprises que l’on finirait par faire la chasse aux savants pour les noyer, comme au Moyen Âge.”
Arkadi Filine, liquidateur
“Monologue à deux voix pour un homme et une femme
Nina Konstantinovna et Nikolaï Prokhorovitch Jarkov. Il enseigne le travail manuel et elle, la littérature.
Elle :
« J’entends si souvent parler de la mort que je ne vais plus aux enterrements. Avez-vous entendu des conversations d’enfants sur la mort ? En sixième, ils se demandent si cela fait peur ou non. Il n’y a pas si longtemps, à leur âge, ils voulaient savoir comment naissent les bébés. Maintenant, ils s’inquiètent de savoir ce qui se passerait après une guerre atomique. Ils n’aiment plus les œuvres classiques : je leur récite du Pouchkine et ils me regardent avec des yeux froids, détachés… Un autre monde les entoure… Ils lisent de la science-fiction. Cela les entraîne dans un monde différent, où l’homme se détache de la terre, manipule le temps… Ils ne peuvent pas avoir peur de la mort de la même manière que les adultes… Que moi, par exemple. Elle les excite comme quelque chose de fantastique.
Je réfléchis à cela. La mort tout autour oblige à penser beaucoup. J’enseigne la littérature russe à des enfants qui ne ressemblent pas à ceux qui fréquentaient ma classe, il y a dix ans. Ils vont continuellement à des enterrements… On enterre aussi des maisons et des arbres… Lorsqu’on les met en rang, s’ils restent debout quinze ou vingt minutes, ils s’évanouissent, saignent du nez. On ne peut ni les étonner ni les rendre heureux. Ils sont toujours somnolents, fatigués. Ils sont pâles, et même gris. Ils ne jouent pas, ne s’amusent pas. Et s’ils se bagarrent ou brisent une vitre sans le faire exprès, les professeurs sont même contents. Ils ne les grondent pas parce que ces enfants ne sont pas comme les autres. Et ils grandissent si lentement. Si je leur demande de répéter quelque chose pendant le cours, ils n’en sont même pas capables. Parfois, je dis juste une phrase et leur demande de la répéter : impossible, ils ne la retiennent pas… Alors, je pense. Je pense beaucoup. Comme si je dessinais avec de l’eau sur une vitre : je suis seule à savoir ce que représente mon esquisse. Personne ne le devine, ne l’imagine.”
“Je travaillais à l’inspection pour la préservation de la nature. Nous nous attendions à recevoir des ordres, mais ils ne venaient pas. Parmi le personnel de l’inspection, il n’y avait presque pas de professionnels, en particulier dans la haute direction : des colonels en retraite, des anciens fonctionnaires du parti, à la retraite ou indésirables. Des types qui avaient commis des fautes et qu’on envoyait chez nous, à remuer la paperasse. Les gens ont réellement commencé à en parler après une intervention publique, à Moscou, de notre écrivain biélorusse Aies Adamovitch qui a sonné le tocsin. Comme ils le détestaient ! C’était totalement irréel. Leurs enfants vivaient là, leurs petits-enfants, mais ce n’étaient pas eux, mais l’écrivain qui criait à la face du monde : Sauvez-nous ! L’instinct de préservation aurait dû prévaloir, mais, lors des réunions du parti et même dans des conversations privées, ils exprimaient leur indignation contre ces “écrivaillons” : “De quoi se mêlent-ils ? Ils laissent aller leur langue ! Il y a les ordres ! La subordination ! Et puis, qu’est-ce qu’il y comprend, celui-là ? Il n’est pas physicien. Il y a tout de même le Comité central ! Le secrétaire général !” C’est à ce moment que j’ai réellement compris pour la première fois ce qu’avait été l’année 1937. Comment tout cela avait pu se passer…
Au moment de Tchernobyl, j’avais une idée idyllique des centrales nucléaires. À l’école, à l’institut, on nous apprenait que c’étaient des “usines fantastiques qui fabriquaient de l’énergie à partir de rien”, où des gens en blouses blanches, assis devant de grandes consoles, appuyaient sur des boutons. L’explosion de Tchernobyl a eu lieu alors que notre conscience n’y était pas préparée. De plus, il n’y avait aucune information. Nous recevions des montagnes de papiers avec la mention “strictement confidentiel” : “garder secrètes les informations sur l’accident”, “garder secrètes les informations sur les résultats du traitement des malades”, “garder secrètes les informations sur le degré de contamination radioactive du personnel ayant participé à la liquidation”…”
Zoïa Danilovana Brouk, inspecteur de la préservation de la nature


 Follow
Follow