Entretien avec Samuel Mayol, directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Saint-Denis (intégrale de la vidéo ici)
Samuel Mayol et Jacques Adrien Perret viennent de publier Pour un système éducatif réaliste et sans élitisme aux éditions L’Harmattan – Questions contemporaines. Après un état des lieux quant à la situation de l’enseignement supérieur et à l’effet des deux dernières lois qui le concerne, les auteurs proposent des solutions qui, pour iconoclastes qu’elles sont actuellement, n’en sont pas moins séduisantes, voire réalistes comme ils se plaisent à le défendre.
Première partie : état des lieux
Les questions posées :
L’autonomie des universités est-elle un bien ? Peut-on garantir que des liens financiers avec les entreprises n’imposent pas des formations spécifiques dites utiles au détriment de formations dites non rentables ? Est-il possible, dans une société néolibérale comme la nôtre, de conserver la primauté de l’individu sur sa rentabilité économique ? Est-ce le rôle de l’université de fournir des professionnels aux entreprises ? Qu’est une formation rentable ? Peut-on calquer la construction de l’esprit sur la fabrication d’un produit ?
L’autonomie des universités est-elle un bien ou un mal ?
L’autonomie des universités a fait récemment l’objet de deux textes de loi. A la question de savoir s’il s’agit d’un bien ou d’un mal, Samuel Mayol, lui, parle plutôt d’abandon des universités par l’état. Si l’autonomie des universités (dont il faut placer l’origine en 1968) était un bien par beaucoup d’aspects, les diverses réformes impliquent un désengagement de l’état du point de vue financier. Un tel désengagement (qui peut, comme c’est le cas de l’IUT de Saint Denis, aller à une réduction des subventions aux formations les portant au ¼ de ce qu’elles étaient) oblige les structures à trouver des financements propres. Or c’est bien là que le bas blesse puisque cela peut conduit à lever des fonds privés pour pouvoir subvenir au minimum de besoins. Cela pose une série de questions dont les moindres ne sont pas celles liées à la rentabilité des formations, donc à la suppression des non rentables, et à l’état de la recherche. Celle des rapports de pouvoir mériterait d’être également mise sur la place publique en ce qu’elle produit des effets délétères dont, finalement, toute la société pâtit indirectement. Inutile d’aborder non plus les aspects administratifs dont tout étudiant a subi les graves carences, jusque parfois dans la validité de l’édition des notes.
Enseignement supérieur, budgets et rentabilité des formations
L’autonomie des universités telle que conçue après 1968 a certes conduit à une très importante multiplicité des formations. Peut-être trop importante. En tout cas l’argument est largement utilisé de même que ceux attenant aux divers problèmes de gestion comme cela apparaît de manière aigüe dans certaines situations conflictuelles entre universités et Etat.
Or l’effet essentiel vient du désengagement de l’état abordé plus haut.
Il n’en reste donc pas moins que la tentation néolibérale et le modèle anglo-saxon produisent là encore leurs effets, si tant est qu’on va, comme beaucoup le soulignent vers « une privatisation de l’université » comme l’argumente également Samuel Mayol. Et ce, bien malheureusement, quels que soient les gouvernements.
L’autonomie des universités, telle qu’elle apparaît dans les textes actuels conduit donc à une situation qui fait « qu’on s’intéresse d’abord à avoir des formations rentables que les entreprises vont financer à travers de la taxe d’apprentissage ou des contrats de professionnalisation plutôt que de savoir si les formations sont utiles pour les étudiants ».
Rentabilité des formations, pour quel sens ?
Qu’est-ce qu’une formation rentable ? Rentable pour qui ? Rentable pour quoi ? Rentable sur quels critères ? Il est admis très souvent actuellement que l’université n’est pas rentable en ce qu’elle ne fournit pas des jeunes immédiatement disponibles pour les entreprises, donc qu’elle fournit des jeunes qui ne trouvent pas de travail à la sortie parce qu’incompétents, là où les écoles, elles, sont performantes, a priori les grandes écoles. Faut-il donc sortir d’une grande école de commerce ou de Polytechnique pour être une personne socialement valable ? La Rolex à trente ans serait donc la seule référence ? En clair, la rentabilité d’une formation est-elle de fournir un jeune considéré comme un simple produit directement utilisable par une entreprise pour un maximum de profit ? Et ce dans des cadres idéologiques néolibéraux et des évaluations de compétences considérés comme évidents sans que leurs fondements idéologiques ne puissent être remis en cause. ? On peut légitimement penser, à l’inverse, que l’intérêt réel d’une société n’est justement pas de produire des individus adaptés, comme on produit des assiettes ou des voitures. Sauf à n’être que celui de la toute petite minorité qui en tire profit.
Or, s’il est bien évident que le budget d’une structure d’enseignement supérieur, université ou autres IUT, se doit d’être en équilibre, la nécessité de lever des fonds auprès des entreprises, par l’intermédiaire de contrats ou de fondations, implique une ségrégation de fait entre les formations et, donc, la suppression de celles qui n’apparaissent pas directement « rentables ». Pourtant ces dernières peuvent s’avérer très utiles pour la société, bien que dans une telle obligation. C’est le cas de certaines, dont parle Samuel Mayol, obligées de fermer faute de subventions suffisantes pour rémunérer les enseignants. Or des formations comme celles centrées sur la création d’entreprises peuvent pourtant permettre de retirer un certain nombre de personnes des rangs de pôle emploi par exemple.
Pour les mêmes raisons le problème de la recherche se pose également de manière cruciale. Une société peut-elle se passer de recherche fondamentale indépendante ? La mort d’une telle recherche n’est-elle pas, à terme, la mort d’une société ? A moins de penser que la toute recherche ne doit être que liée à l’industrie, qu’elle soit pharmaceutique ou agroalimentaire par exemple, avec toutes les conséquences qu’on en connaît. Il y a malheureusement actuellement là encore de quoi être très pessimiste. (lire à ce sujet l’article publié dans le monde.fr édition abonnés daté du 19 février dernier à lire dans le blog de Camille Thomine.
Compétences, savoirs et savoir-faire, la lutte
Un des grands paradoxes actuel se situe, encore pour l’instant, en amont de l’université, en ce que d’un côté il oppose savoirs académiques (traditionnellement le fait de l’enseignement général et théoriquement une partie de l’enseignement technologique) et savoir-faire, fait surtout de l’enseignement professionnel (qui a développé en premier les évaluations par compétence). Or, à y regarder de plus près, on assiste de fait à une attaque en règle, le plus souvent sournoise, des savoirs et l’opposition savoirs savoir-faire de fait ne tient plus guère. En fait, depuis un certain nombre d’années et surtout les récentes réformes, on élude les savoirs au profit des savoir-faire, les connaissances vraies devenant en pratique inutiles. L’évaluation actuelle par compétences en est souvent une caricature. A cela se superpose la dégradation de l’enseignement technologique et la relégation au troisième plan de l’enseignement professionnel.
Or, aujourd’hui, pour acquérir un vrai savoir-faire, il faut peut-être acquérir un vrai savoir ! Donc coordonner des savoir-faire à de vrais savoirs et non réduire des savoirs à des savoir-faire, comme c’est la tendance, même en enseignement général et notamment dans les disciplines scientifiques. Il faut cesser de mettre les deux en opposition.
En amont de l’enseignement supérieur
La question de l’enseignement secondaire est une vraie question. Que produisent les lycées ? Que fournissent-ils comme sujets possibles de formation à l’enseignement supérieur ? On connait l’échec du lycée, avec les difficultés majeures d’un grand nombre de titulaires du baccalauréat : très handicapante absence de maîtrise de la langue tant au niveau de la syntaxe que du vocabulaire de base, méconnaissance de fond, de manière générale pour certaines filières, d’opérations élémentaires comme l’addition ou la multiplication ou de notions mathématiques simples, méconnaissance des techniques de travail de base (hors classes préparatoires ou « bons lycées »), comportements largement inadaptés qui se retrouvent d’ailleurs actuellement lors du démarrage de la vie professionnelle. On connait le taux d’échec qui en est la conséquence dans les premières années d’enseignement supérieur.
Il faudra bien que cet enseignement secondaire soit totalement revu. Le baccalauréat, qui était l’examen permettant de vérifier des acquis de base nécessaires pour suivre un enseignement supérieur n’a, du fait des pratiques actuelles, plus d’autre sens que celui d’une initiation plus ou moins sadique, d’un bizutage comme intégration à un certain type de société censée être performante. Il faudra donc bien en venir à sa suppression mais, parallèlement, à une refonte totale de l’enseignement en redonnant notamment une véritable place aux enseignements technologiques et professionnels sur des modes déjà performants dans certains secteurs, celui de l’enseignement agricole par exemple.
A suivre, deuxième partie, « Pour un enseignement réaliste et non élitiste » :
Redonner des objectifs aux élèves et du sens à l’école et à la formation ? La suppression du bac ? Sortir certains enseignements technologiques et professionnels de la tutelle de l’Education Nationale ?

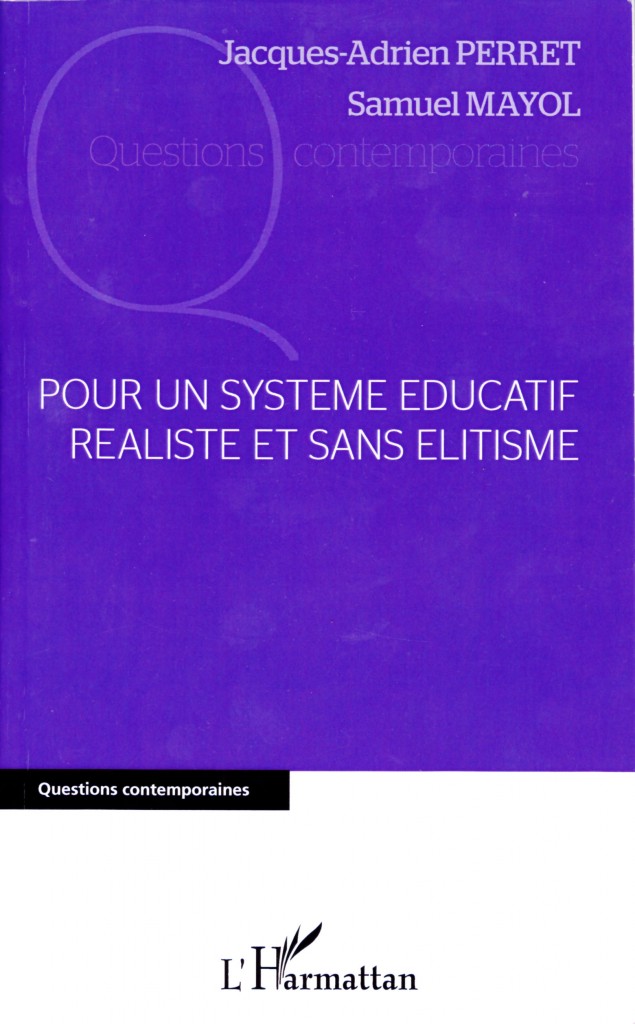

 Follow
Follow