
J’ai choisi cette photographie du monument aux morts d’Equeurdreville (Normandie), monument qualifié de “pacifiste” inauguré en 1932, pour marquer cette date du 3 août. Il y a cent ans, l’Allemagne avait déclaré la guerre à la France après l’avoir déclarée à la Russie, le 1er Août. Les deux premiers morts de la guerre étaient tombés dans le Territoire de Belfort le 2 août : le caporal français Jules Peugeot et le lieutenant allemand Albert Mayer.
La question n’est pas ici celle du pacifisme. Il conviendrait de définir le terme, surtout d’en analyser l’échec et le basculement dans le « consentement à tuer »(Marc Crépon). La photographie dans mon esprit constitue une protestation silencieuse contre l’appel du gouvernement à faire sonner le tocsin avec la bénédiction des Églises, le 1er août. Pour… fêter ? Et quoi ? L’ordre de mobilisation générale de la République française, il y a cent ans.
Un appel et un tocsin indécents à double titre. Sur le plan général et sur le plan local de l’Alsace -Moselle qui s’y est associée.
Le début d’une guerre n’a rien de glorieux. Commencer par ce tocsin revient à dédouaner la France de toute responsabilité. Qu’a-t-elle fait pour en empêcher le déclenchement ? Les lecteurs du quotidien l’Alsace ont eu, inséré dans l’édition du 1er août de leur journal, un fac-similé de l’affiche de mobilisation générale. Ils pouvaient en vérifier sa date d’impression : 1904. Elle était prête depuis 10 ans. Pourquoi sommes nous, en France, privés du débat sur les origines de cette guerre ?
Au Mans, cloches et sirènes sont restées silencieuses. Pour le maire,Jean-Claude Boulard, « on ne célèbre pas le centenaire du déclenchement d’une guerre qui a fait tant de morts ». Il a bien raison. Car :
« Ce centenaire-là ne saurait être une fête. Car ce qui commence en 14, d’abord, et qui ne s’est certes pas achevé depuis, n’est pas simplement une bataille ou une série de batailles : c’est l’épreuve d’une violence de masse, et d’une violence extrême. L’histoire a mis bien longtemps à le reconnaître, à y voir un fait central, et il serait paradoxal et à vrai dire scandaleux qu’on l’oublie de nouveau aujourd’hui, à l’heure du centenaire le plus officiel
Le bilan de « 14 » ne tient pas seulement à la mortalité de masse produite par l’immense conflit. L’« acquis de violence » a trait aussi à l’extension du phénomène concentrationnaire, apparu dès la charnière du XIXème et du XXème siècle, mais qui trouve au cours des année de guerre une systématisation nouvelle ; il tient au ciblage des populations désarmées, qui désormais incarnent aussi l’ennemi : le génocide des Arméniens perpétré en 1915 constitue la pointe extrême de cette logique nouvelle de l’élimination. À quoi s’ajoute l’après-coup : les deux grands totalitarismes du XXème siècle ne l’ont pas emporté – l’un en 1917, l’autre en 1933 – en raison seulement de l’ampleur des ruines laissées par le conflit : atroces héritiers des grandes attentes véhiculées par la guerre, ils ont réinvesti dans le champ politique les pratiques de violence qu’elle avait générées »
Extrait de Fréderic Worms, Christophe Prochasson, Stéphane Audouin- Rouzeau, Marc Crépon : 1914 : questions pour une commémoration Revue Esprit Mai 2013
Le 1er août 1914 en Alsace
J’évoquais plus haut la présence de l’ordre de mobilisation dans le quotidien régional. il faut se demander : mais que vient-elle faire là ? Cherche-t-on à perpétuer le mensonge et faire croire que la population alsacienne était pareillement concernée ? Que nos grands-pères étaient des poilus ? En est-on toujours là 100 ans après ?
En Alsace, le tocsin n’a pas sonné en 1914. Et pour cause ! L’Alsace était annexée à l’Empire allemand depuis quarante ans en vertu du Traité de Francfort de 1871. Les Alsaciens ont été mobilisés dans l’armée impériale . On pourra lire ci-dessous un extrait de ce qui est sans doute le meilleur témoignage sur cette guerre vue par un Alsacien :
“Le 30 juillet 1914, fatigués par nos activités, on alla se coucher de bonne heure. Vers dix heures du soir environ, la porte de notre chambrée s’ouvrit brutalement et l’adjudant de compagnie nous ordonna de nous lever aussitôt: la guerre était apparemment inévitable. Nous étions abasourdis et incapables de la moindre parole. La guerre, où, contre qui ? Bien sûr, tous réalisèrent très vite qu’il s’agissait de combattre la France. Soudain, l’un d’entre nous entonna le Deutschland über alles, presque tous le suivirent et bientôt ce chant résonna dans la nuit, repris par des centaines de poitrines. Je n’avais pour ma part aucune envie de chanter, parce que je pensais qu’une guerre offre toutes les chances de se faire tuer. C’était une perspective extrêmement désagréable.(…) On nous donna l’ordre de faire notre paquetage au plus vite, et alors qu’il faisait toujours nuit, on se mit en marche vers la gare de Hausen, dans la vallée du Danube. Comme il n’y avait pas de train pour nous, nous sommes retournés au camp jusqu’au prochain soir, avant de rentrer à Mulhouse, notre ville de garnison, dans un train bondé, serrés les uns contre les autres comme des harengs saurs dans un tonneau. On arriva à destination le matin du 1er août 1914, à six heures, et on se mit en marche vers la caserne. On devait être au repos jusqu’à midi, mais dès neuf heures, je fus réveillé avec d’autres camarades pour aller percevoir un équipement de guerre tout neuf. Chacun de nous reçu cent-vingt cartouches. Après cela on dut passer à l’armurerie, faire aiguiser nos baïonnettes. »
Dominique Richert : Cahiers d’un survivant (Nuée Bleue page 13-14)
Il combattra ensuite contre les Français dans la bataille de Mulhouse du 9 au 12 août 1914.
Alors que l’archevêque de Strasbourg invitait à sonner le tocsin à contresens de l’histoire, les évêques de Belgique, eux, invitent à sonner le glas, le 4 août, date du début de la guerre en Belgique, “pour rendre hommage aux victimes innombrables de cette guerre, quelque fût leur camp“.
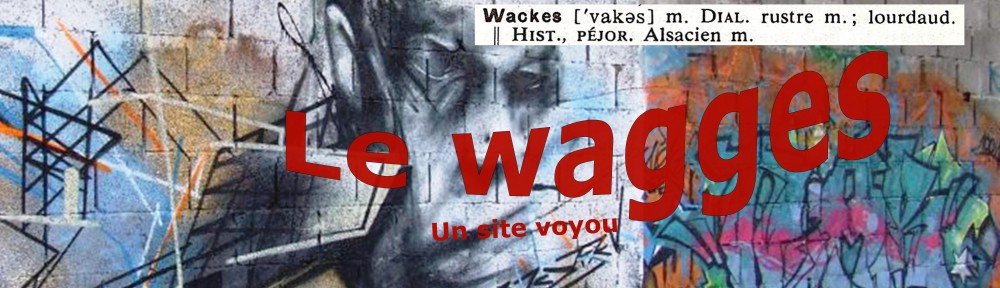

 Follow
Follow
